

PARIS
Centre historique et touristique de la ville,
le 1er septembre 2016.
La Mairie de Paris prend la décision de fermer à la circulation automobile les voies sur berges rive droite en bord de Seine.
3.3 kilomètres sont désormais dédiés aux flâneurs parisiens, partant du jardin des Tuileries et allant jusqu’au bout de l’île Saint Louis. Que vous soyez piétons ou cyclistes, en famille, entre amis ou seul, vous pouvez désormais venir vous promener ou profiter des nouveaux aménagements de loisirs qui s’y trouvent.
Mais derrière ce calme apparent et ces cris d’enfants se cachent des mesures, débats et enjeux multiples, et surtout la métamorphose progressive d’un problème public - la place prise par la voiture dans les villes - à une controverse fortement médiatisée devenant de plus en plus composite et multifacette.
L'ère du
Politique
2016-2017. Faisant fi des avis défavorables de plusieurs études, le projet de piétonnisation des voies sur berges est mis en place par la Mairie de Paris. À la suite de cette décision, les avis divergent et le débat s’intensifie politiquement autour des voies sur berges.
L'ère du
Subjectif
2018. Le Tribunal administratif de Paris annule la décision de fermeture à la circulation des voies sur berges. Anne Hidalgo et ses partisans mettent tout en oeuvre pour sauver le projet, ce qui implique un changement d’arguments : plus subjectifs, moins quantifiables, cherchant à projeter une certaine vision de l'avenir.
X
X
ÉTAPES CLÉS
L'ère de la
Mesure
2015 - 2016. Élue Maire de Paris, Anne Hidalgo porte sur le devant de la scène son projet de piétonniser les voies sur berges de la rive droite. De nombreuses études sont alors réalisées quant au bien fondé du projet, et les mesures qui en ressortent sont au coeur du débat public.
X
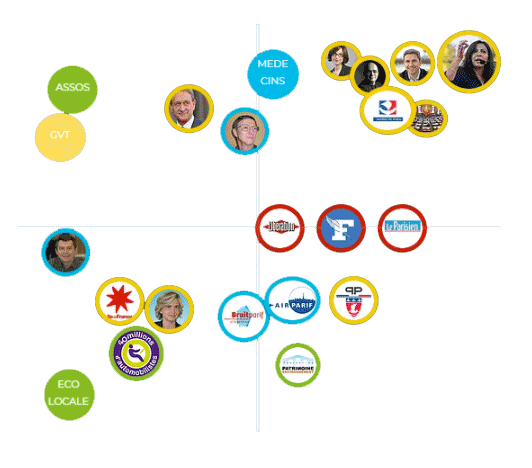
ETAPE
CARTOGRAPHIE
DES ACTEURS
Les voix sont nombreuses à s'élever sur les berges.
Politiques, scientifiques ou encore associatifs prennent ainsi position sur la controverse et leur poids, leur portée et même leur avis sur le projet fluctuent au fur et à mesure des rebondissements de la controverse.
Cartographier non seulement la position des acteurs mais également l'évolution de celle ci au cours des trois étapes clés est ainsi révélateurs des enjeux au coeur de la controverse.
CONCLUSION
Les trois temps du débat
La fermeture des voies sur berges rive droite s’est appuyée au départ sur un argumentaire technique et scientifique. Anne Hidalgo a affiché une volonté ferme de chasser la voiture hors de la ville pour rendre l’air de Paris plus respirable. Cette mesure s’inscrit dans un souci global de rendre les métropoles éco-responsables et plus durables.
Pourtant, les organismes auxquels Anne Hidalgo a dû faire appel pour voir son projet aboutir n’ont pas été nécessairement dans son sens, il en va de la Commission d’enquête qui n’a pas pu évaluer, à partir de l’étude d’impact, la réalité d’une réduction de la pollution induite par la fermeture des voies sur berges rive droite. Bientôt, l’argument de la qualité de l’air a dû faire place à un autre argument d’autorité : l’éthos de la maire de Paris.
Malgré l’avis défavorable de la Commission d’enquête, Anne Hidalgo, appuyée par le Conseil de Paris, décide de fermer aux automobilistes la berge rive droite. Dès lors, les médias se sont emparés de cette démonstration de force pour taxer la Maire de personnage autoritaire usant d’une méthode tout autant arbitraire. A son tour, la région a déploré un manque de concertation, elle qui estime qu’elle aurait pu et dû aussi avoir son mot à dire sur un axe qui concerne une majorité d’automobilistes de banlieue. Valérie Pécresse, loin d’avoir rejeté l’idée d’une piétonnisation, a critiqué la méthode qui, selon elle, devait être appliquée, tant sur le plan politique que décisionnel, à l’échelle de toute l’Ile-de-France et sur un temps de mise en place plus long.
Enfin, en parallèle de cette mise en avant de sa personnalité dans la prise de décision, Anne Hidalgo a développé un argumentaire toujours plus fondé sur des éléments relevant du subjectif et non plus de l’objectif comme précédemment avec les critères scientifiques. La décision du Tribunal Administratif de Paris ne met pas un point final à ce projet, bien au contraire, elle relance le débat et surtout la polarisation des acteurs autour du projet. Désormais, la qualité de vie, ce que doit être la ville de demain, l’appropriation de la ville et du fleuve par les habitants et les nouvelles formes de mobilités sont les arguments qui prennent le dessus sur ceux de santé et de qualité de l’air.
Une multiplicité des enjeux
Si les acteurs de cette controverse ne sauraient être vus que sous l’angle d’une division “pour ou contre” le projet, c’est bien parce que les problématiques soulevées par l’enquête que nous avons menée pendant plusieurs mois mettent en lumière la complexité de celle-ci.
Tout d’abord, cette controverse est éminemment politique et politisée. Et parce qu’elle est politique et politisée, elle en devient fortement médiatisée. Or ces deux arènes, les médias et la prise de décision politique, ont été nos deux portes d’entrées dans l’enquête.
La chronologie allant de la construction des voies comme autoroute urbaine à la fin des années 1960 à leur piétonisation aujourd’hui nous a permis de nous rendre compte de l’évolution des objectifs politiques et sociaux attribués aux voies sur berges. De facilitateur de déplacement automobile au sein de la ville, elles sont devenues des lieux emblématiques de ce que doivent être désormais les bords de fleuves dans les grandes villes, selon une tendance mondiale de littoralisation des sociétés et de reconquête des berges.
C’est aussi au travers d’une analyse médiatique approfondie, que nous nous sommes rendus compte de la prédominance de certains enjeux dans les discours des différents acteurs, qu’ils soient politiques, associatifs ou encore scientifiques.
Cette controverse transcende le simple cadre politique et surtout le simple cadre local de Paris, comme le rassemblement “Sauvons les Berges” du 10 mars 2018 l’a bien illustré. Ce projet a des conséquences à l’échelle parisienne, francilienne, régionale mais aussi même nationale, car il influe sur et est influencé par des politiques menées dans d’autres villes, comme à Grenoble ou à Bordeaux, villes précurseures en matière de ville plus durable et mettant en valeur les abords de fleuve.
Des visions de la ville qui s'affrontent
La piétonisation des voies sur berges et d’une manière plus générale la politique menée par Anne Hidalgo en matière de mobilité, laissent aussi transparaître une conception spécifique de ce que doivent être les déplacements dans la ville de demain.
Ce qui se joue en réalité, c’est un affrontement autour du concept de mobilité urbaine. Pour certains, comme l’association 40 Millions d’automobilistes, les associations d’usager franciliens ou celles de mairies de communes de la banlieue parisienne, la mobilité urbaine de la ville de demain, d’une ville plus durable, ne doit pas nécessairement exclure la voiture hors de la ville. Pour eux, exclure la voiture de Paris, c’est marginaliser nombre de personnes vivant hors de Paris pour des raisons le plus souvent économiques et qualitatives (plus grands espaces, qualité de vie) et venant travailler à Paris. La fermeture des voies sur berges est perçue comme une politique de marginalisation et d’exclusion. D’autant que le déplacement en voiture inclut une dimension psychologique et sociale forte: la voiture est synonyme d’émancipation, de liberté.
Pour les autres, bien au contraire, une ville durable doit repenser totalement son rapport à la mobilité et développer des modes de transports “doux” déjà existants (vélos, transports en commun, marche à pied) et être créative pour en développer de nouveaux.
Mais ces changements, quels qu’ils soient, ne peuvent se faire sans changement des comportements et des pratiques des habitants. La question qui se pose souvent, et à laquelle nous ne sommes pas parvenus à trouver un consensus, est de savoir si ces modifications doivent être imposées par le haut, c’est-à-dire par des prises de décisions politiques, ou bien si celles-ci doivent venir du bas, c’est-à-dire de la société civile. La solution est sans aucun doute un savant mélange, reste à en trouver les proportions exactes pour que les acteurs puissent trouver un terrain commun d’entente.
La question des mesures dans les processus décisionnels
Les acteurs sont nombreux, divers et s’appuient tous sur des données et/ou des arguments de différentes natures, ce qui nécessite une analyse minutieuse et parfois laborieuse de leur structure argumentative et langagière ainsi que de leurs appuis (plus ou moins) scientifiques et techniques.
Au fur et à mesure de notre enquête, nous avons compris qu’il y a un véritable enjeu autour de la quantification et de la catégorisation des données dans cette controverse, qui se transforme en “bataille des chiffres” pour reprendre l’expression si souvent utilisée par les médias. On en arrive à un point où c’est le constat zéro pour les arguments quantitatifs fondés sur des mesures scientifiques. Mais ceci peut-être aussi parce qu’une décision impliquant de tels changements nécessitent pour en mesurer l’efficacité un suivi sur le long terme. Mais là encore, le consensus n’existe pas entre les différents acteurs sur la durée: un an, deux ans, cinq ans ?
Pour Anne Hidalgo et ses soutiens, cette décision va “dans le sens de l’histoire”, il faut choisir et décider le progrès pour que celui-ci arrive. Pour ses opposants, à trop vouloir imposer, Anne Hidalgo s’est perdue elle-même dans les méandres d’une décision politique unilatérale qui n’aurait pas dû l’être.
Les voies sur berges n’ont donc pas fini de faire couler de l’encre et de faire entendre de nombreuses voix, harmonieuses ou dissonantes, selon votre perspective.
